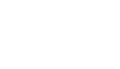Des salons aux théâtres
lieux des rencontres parisiennes
La IIIIe République, au moins jusqu’à l’arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936, a peu soutenu la création musicale en comparaison des commandes que le régime passa régulièrement aux artistes plastiques. Ce désintérêt relatif explique en partie le rôle de substitution dévolu aux salons tenus par la grande bourgeoisie et l’aristocratie de l’époque. Les élites voyaient dans ces activités un moyen de légitimer socialement leur rang et d’entretenir leur cohérence de classe autour de préoccupations apparemment distinctes des mondes financier et économique, dans lesquels la plupart des mécènes évoluaient, ou dont ils avaient hérité. Quant aux compositeurs, ils trouvaient là un soutien efficace, sur le plan matériel autant que symbolique. La « mondanité féconde » que le système des salons rendit possible, selon l’expression d’Anne Martin-Fugier, découlait en effet du « mariage incontestablement fructueux de l’avant-garde et du snobisme », comme l’écrit pour sa part Myriam Chimènes, qui voit dans l’institution salonnière « l’antichambre des salles de concerts ».
Les salons : espaces de sociabilité & d’émulation
L’importance acquise par les salons dans la vie artistique parisienne des années 1870-1930 se concentre essentiellement à Paris d’abord, dans les beaux quartiers de l’Ouest de la capitale, et plus particulièrement autour de la plaine Monceau enfin. Dans les VIIIe et XVIIe arrondissements se concentrent en effet la majorité des salons où artistes, écrivains et journalistes sont reçus chaque semaine par leurs hôtes. Ces rencontres, favorisées par la proximité géographique entre les appartements des compositeurs, les ateliers des peintres et des sculpteurs et les hôtels particuliers de leurs mécènes, favorisent en retour l’émulation et les collaborations.
Parmi bien d’autres œuvres comparables, le portrait de groupe peint en 1910 par Georges d’Espagnat (1870-1950) témoigne de ce phénomène de manière éloquente. La scène se déroule au 22 rue d’Athènes, entre le quartier bohème précisément surnommé « la Nouvelle Athènes » et le parc Monceau, dans l’appartement de Cipa Godebski (1875-1937), demi-frère de la pianiste et mécène Misia Sert (1872-1950), à laquelle Ravel dédia sa Valse. Le compositeur est représenté accoudé sur le piano sur lequel joue son ami Ricardo Viñes (1875-1943), rencontré au Conservatoire en 1889, juste en face (respectivement le premier et le troisième en partant de la gauche) de Florent Schmitt (1870-1958) et Émile Vuillermoz (1878-1960), avec lesquels il venait de fonder la Société musicale indépendante. Un peu en retrait, le peintre a également figuré Albert Roussel (1869-1937), le futur auteur de Bacchus et Ariane (1930).
Les théâtres :
espaces de création & de consécration
Un nombre remarquable de compositions de premier plan ont été créées dans les salons, devant un public averti et critique, à même de prononcer un premier jugement et de leur ouvrir, le cas échéant, d’autres portes. Car le véritable lieu de consécration pour les musiciens reste le théâtre, qui n’en demeure pas moins lié aux salons d’une manière ou d’une autre. Par exemple, lorsqu’il est d’initiative privée et qu’il est pensé comme un lieu de création et de rencontre pour tous les arts, comme le fut le Théâtre des Champs-Élysées au début du siècle dernier.
Éditeur musical et impresario, organisateur de concerts pour de nombreux salons privés, Gabriel Astruc (1864-1938) est à l’origine du Théâtre des Champs-Élysées, inauguré en 1913. Il fait pour cela appel à des architectes pionniers, Henry van de Velde (1863-1957) d’abord, puis Auguste Perret (1874-1954), qui dotent ainsi Paris de son premier bâtiment de style Art Déco : à la fois organique et classique, où les éléments décoratifs demeurent strictement soumis à la structure architecturale.
Les bas-reliefs commandés au sculpteur Antoine Bourdelle (1861-1929) représentant, entre autres, La Musique et La Danse, trouvent néanmoins à s’intégrer à la façade sous formes de métopes (éléments figuratifs traditionnellement placés entre des éléments géométriques). Les décors peints du plafond de la salle de concert, quant à eux, ont été confiés à Maurice Denis (1870-1943), déjà célèbre internationalement pour ses vastes peintures d’intérieur – notamment pour le collectionneur moscovite Ivan Morozov (1871-1921) –, et prisé en France pour son alliance tempérée d’audace chromatique et de composition rigoureuse. L’exemple de Denis inspire encore (et pour longtemps) Ker-Xavier Roussel (1867-1944) lorsqu’il conçoit en 1912 le rideau de scène du théâtre, avec ses couleurs vives et son thème mythologisant. Son beau-frère, Édouard Vuillard (1868-1940), s’en éloigne cependant avec la toile qu’il réalise pour le Petit café, plus en accord en effet avec l’esprit des grandes affiches de cabaret que peignait Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901).
La création musicale
au miroir de la presse de l’époque
Dans la mécanique sociale bien huilée qui fait passer la création musicale des salons aux théâtres, la presse joue à l’occasion le rôle du grain de sable dans les rouages. En France, la critique artistique avait adopté une posture politique bien avant l’avènement de la IIIe République, mais la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui accorde de droit une licence quasi-totale en termes de jugement.
Dès lors, rien d’étonnant à ce que l’éminent directeur du Théâtre des Champs-Élysées se voit attaqué. Le caricaturiste Sem (1863-1934) moquait déjà l’importance qu’il avait acquise comme agent artistique au début du siècle dernier. Lorsqu’Astruc prend la direction du Théâtre des Champs-Élysées, où il fait créer, le 29 mai 1913, le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky (1882-1911), la plume du dessinateur redouble de férocité et il légende l’ambigu tango où il imagine Astruc collé à Vaslav Nijinski (1889-1950) d’un « Massacre du printemps ».
Ses confrères avant lui s’en étaient déjà pris à d’autres créations qui furent pourtant jugées moins scandaleuses. Dans un style d’imagerie moins acerbe, Ferdinand Lefman (1827-1890 ?) avait qualifié Namouna d’Édouard Lalo (1823-1892), à sa création en 1882, de « ballet archipelliculaire ». Une dizaine d’années plus tard, probablement à l’occasion de la création du Prélude à l’après-midi d’un faune (1892-1894) de Debussy, Manuel Luque (1854-1924) avait tourné en dérision l’auteur du poème dont le compositeur s’était inspiré : Stéphane Mallarmé, montré en faune innocent, jouant de la flûte de Pan, coiffé d’une auréole, les hanches ceintes d’un linge pudique, alors même que le critique Gaston Calmette (1858-1914) s’était ému, dans les pages du Figaro, d’avoir dû assister à la bacchanale d’« un Faune inconvenant avec de vils mouvements de bestialité érotique et des gestes de lourde impudeur. »