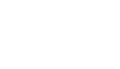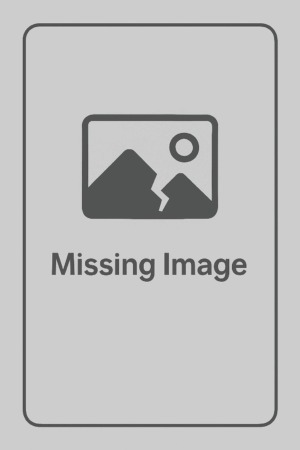Max Deutsch
& la politique
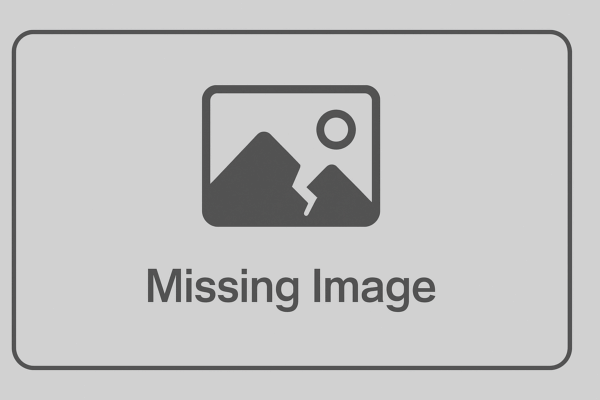
Max Deutsch
& la politique
Chez Max Deutsch, le concept de combat n’était pas seulement artistique. On connaît ses états de service militaires durant la Première Guerre mondiale, son empathie pour les Républicains espagnols, sa présence dans la Légion étrangère puis parmi la Résistance française au cours de l’Occupation. Bien qu’ayant des origines bourgeoises, Deutsch afficha tôt des divergences politiques avec son père, ayant été distingué par l’Empereur François-Joseph (1830-1916). En outre, il ne se fit jamais appeler sous son prénom complet de Maximilien. Il n’appréciait pas cette référence à Maximilien d’Autriche (1832-1867), le premier empereur du Mexique.
Deutsch vit de ses yeux la misère régnant à Vienne tout de suite après la Première Guerre mondiale. La population n’avait ni chauffage, ni nourriture. Les habitants de la capitale autrichienne tentaient de s’approvisionner directement chez des agriculteurs. Les transports publics étaient démantelés. Comme Arnold Schönberg était installé à Mödling, localité située à 15 kilomètres de Vienne, il s’avérait impossible de se rendre à ses cours de composition par le train. Témoignage de Deutsch dans le documentaire que lui consacra Mustapha Hasnaoui en 1998 : « Ses élèves, dont moi, se levaient à 6 heures du matin. Nous allions à pied à Mödling. Le parcours aller-retour représentait 30 kilomètres, toujours à pied. »
Malgré une distance de 1950 kilomètres entre Vienne et Moscou, la Révolution d’Octobre avait été suivie de près par une nouvelle génération autrichienne avide de changements. Des décennies plus tard, Deutsch racontait à Hasnaoui : « Vienne est la porte du monde slave, une plaque tournante. Je fus très marqué par la Révolution d’Octobre. Elle nous influença, en particulier après avoir lu Dostoïevski et Gorki, le peintre des humbles dépourvus du moindre confort. » Une fois établi à Berlin où la jeunesse éveillée courtisait les représentants de l’Union soviétique, Deutsch continua à s’informer de l’actualité politique autrichienne. Il apprécia les réalisations sociales du gouvernement de gauche, autant que sa solidarité avec la République espagnole.
Mais les courants manifestant de la sympathie pour le nazisme déstabilisèrent le régime. Une guerre civile éclata en 1934. L’austrofascisme succéda à l’austro-marxisme. Désormais installé en France, Deutsch observa la pente fatale conduisant – en mars 1938 – à l’Anschluss. Déserté par près de 200. 000 Juifs, son pays natal n’existait plus. Il vit aussi le glissement idéologique de certains de ses confrères. Anton Webern se vit protégé par Joseph Goebbels (1897-1945) en personne et profita des largesses financières du NSDAP. Les travaux du musicologue austro-américain Hans Moldenhauer (1906-1987) en firent état en 1978. Comme il était juif, Deutsch éprouva de la compassion pour ses coreligionnaires chassés des rangs de l’Orchestre philharmonique de Vienne et d’autres institutions musicales.
Les années berlinoises de Deutsch s’étant écoulées entre 1921 et 1924 furent marquées par une marche progressive vers la catastrophe. Heureux de sa proximité avec les spartakistes et de la garde armée qu’il montait certains jours devant le siège de leur parti, Deutsch regardait avec désapprobation la misère noire frappant une partie de la population allemande. L’instabilité politique de la République de Weimar se combinait avec une inflation sans contrôle. Klaus Mann (1906-1949) en témoigna de la manière suivante : « Des touristes américains achètent des meubles baroques pour une tartine de beurre, on peut avoir un Dürer authentique pour deux bouteilles de whisky. »
Une fois devenu parisien, Max Deutsch assista aux tourments spectaculaires de la 3ème République. Il vécut le Front Populaire. Comme nombre de musiciens tels qu’Elsa Barraine (1910-1999), Arthur Honegger (1892-1955), Serge Nigg (1924-2008), Charles Koechlin (1867-1950) ou le chef d’orchestre communiste Roger Désormière (1898-1963), il soutint les revendications conduisant entre autres à l’instauration des congés payés. Après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Deutsch entra dans la Résistance et se mit à cultiver plus que jamais les valeurs héritées de la Révolution de 1789. Il s’avérerait intéressant de connaître l’opinion du musicien sur la Guerre d’Indochine et la Guerre d’Algérie, comme sur la puissance du Parti Communiste français avant la révélation des crimes du stalinisme. Tandis qu’Arnold Schönberg avait appelé de ses vœux ardents la création de l’État d’Israël et envisagé d’y effectuer des séjours d’enseignement, Deutsch suivait la même ligne tout en étant convaincu de la nécessité d’une coexistence douce entre celui-ci et les pays voisins arabes.
Adoptant en l’espèce la même position que le penseur Martin Buber (1878-1965), Deutsch eut du fil à découdre avec la partie majoritaire du monde juif dont la doxa était une opposition farouche aux droits des Palestiniens. Il avait une conception universelle et transcendante de la musique. Dans l’hypothèse où Max Deutsch aurait pu atteindre l’âge biblique de 98 ans, il aurait été le témoin de l’écroulement – à partir de 1989 – du bloc soviétique et du retour – en Autriche – de courants politiques antidémocratiques. Il avait lutté contre ceux-ci toute sa vie d’adulte durant.