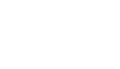Alexander Zemlinsky
l’étranger

Alexander Zemlinsky
l’étranger
Itinéraire d’un musicien à la croisée des mondes
Né à Vienne en 1871, mort près de New York en 1942, le compositeur et chef d’orchestre Alexander Zemlinsky traversa plusieurs mondes, qu’il vit aussi disparaître. En premier lieu, celui de son enfance et de sa jeunesse : l’empire austro-hongrois, « ce monde de la sécurité », comme le décrit son contemporain l’écrivain Stefan Zweig (1881-1942) dans Le Monde d’hier, avant de prendre conscience à son tour qu’il n’était en définitive « qu’un château de nuées ».
Comme Zweig, cependant, Zemlinsky semble n’avoir pleinement vécu que dans un autre monde encore : celui de l’art, auquel il consacra toute son existence. C’est en son sein qu’il trouva sa patrie, une patrie idéale, sans frontières ni passeport, avec la musique pour langage universel et pour baume à cette « identité blessée » dont parlait Michael Pollak (1948-1992) à propos des créateurs viennois qui portèrent l’idée d’art pour l’art au-dessus de celle de nation.
L’œuvre musicale d’Alexander Zemlinsky se situe elle-même à la croisée des mondes : entre Vienne, Prague et Berlin – et avant New York. On décèle en elle certains thèmes de Johannes Brahms (1833-1897), l’empreinte de Gustav Mahler (1860-1911), l’influence rétrospective d’Arnold Schönberg (1874-1951), dont il fut le seul professeur.
Mais ces réminiscences, parfois taxées d’éclectisme, n’ont pas masqué son originalité propre et ses anticipations, le caractère diaphane de sa musique et la violence qui – brusquement – en surgit. À travers elle, Zemlinsky n’a eu en effet de cesse de sonder sa propre étrangeté.
Du compositeur, on pourrait dire ce qu’écrivit Hannah Arendt (1906-1975) du philosophe Walter Benjamin (1892-1940) : « Cet homme n’avait appris à nager ni avec le courant ni contre le courant. » Dans son hommage posthume, Arendt rapprochait Benjamin de cette figure de la chanson populaire allemande qu’est « le petit bossu » (Das Bucklicht Männlein). À la fin de son Enfance berlinoise parue en 1932-1933, Benjamin évoque en effet ce personnage chapardeur et malhabile, auquel il s’identifie et qu’il reconnaît aussi en Franz Kafka (1883-1924) à l’occasion d’un article commémorant les dix ans de la mort de l’écrivain pragois paru les 21 et 28 décembre 1934. Quelques jours auparavant seulement, le 15 décembre, Alexander Zemlinsky terminait un lied précisément intitulé Das Bucklicht Männlein.
Formé à Vienne au temps où celle-ci était donc « moins une ville d’art qu’une ville de décor par excellence », comme l’écrivait Hermann Broch (1886-1951), Zemlinsky ne quitta pourtant la capitale autrichienne qu’à 40 ans passés pour rejoindre Prague. Là, il fit du Neue Deutsches Theater une salle de premier plan et le dirigea pendant encore près de dix ans après l’indépendance de la Tchécoslovaquie.
Il ne revint dans la ville de sa jeunesse qu’après un détour de plus de cinq années à la Krolloper de Berlin où il collabora cette fois avec l’avant-garde de l’époque, adaptant pour ses propres compositions non plus les textes des poètes d’avant-guerre mais ceux du Harlem Revival. En 1933, les nazis l’obligèrent au retour avant de le forcer à l’exil en 1938. De nouveau il vit périr un monde, et sans doute ne fut-il jamais autant étranger qu’à New York où il trouva refuge et mourut en 1942, privé d’appuis et déjà passablement oublié.
L’année d’avant son départ, Alexander Zemlinsky avait composé douze chants où se mêlaient les voix de Goethe (1749-1832), de Stefan George (1868-1933) et de Langston Hughes (1902-1967). Le septième de ces chants, dans lequel on perçoit quelques échos de jazz, s’intitule Elend : « misère » en allemand. Mais l’origine latine du mot désigne aussi le banni, celui qui n’a pas de terre (ali landi), et qui est condamné à vagabonder, entre les mondes et d’une musique l’autre, en quête de l’harmonie perdue.