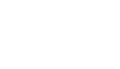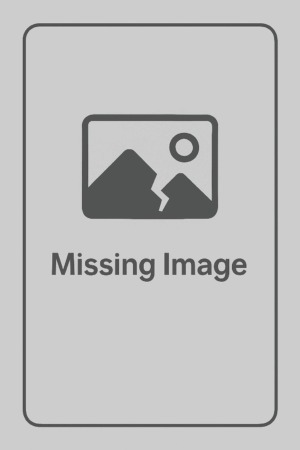Le professeur
et le compositeur
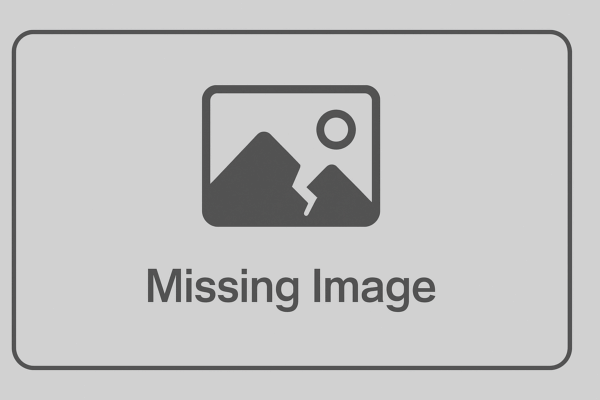
Le professeur
et le compositeur
Formé à l’excellence dans une Vienne où les esprits brillants abondaient, Max Deutsch ne suivit pas que les classes de composition données par Arnold Schönberg. Il assista aussi avant le début de la Première Guerre mondiale aux cours de Guido Adler (1855-1941), l’un des pères de la musicologie moderne, dispensés à l’université de la capitale de l’empire austro-hongrois. L’émulation de Max Deutsch fut également partagée par son propre frère Frederic Deutsch (1902-1991). Après avoir été naturalisé américain sous le nom de Frederic Dorian, il enseigna à l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh. Durant la même période, Schönberg formait des compositeurs à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Frederic Dorian lui rendit visite plus d’une fois.
L’enseignement délivré par Max Deutsch parmi des établissements organisés débuta durant ses années espagnoles, quand il enseignait la musique de film à Madrid peu avant le début de la Guerre civile. Il se poursuivit alors qu’il était presque septuagénaire. Deutsch enseigne à la Sorbonne. Il passe à l’École normale de musique (ÉNM), au cours des dix dernières années de son existence. Le directeur de l’établissement est alors Pierre Petit (1922-2000), connu pour son attachement au langage sonore traditionnel. Petit n’est guère favorable aux références musicales de Deutsch. Leurs relations auront un aspect complexe et tendu. Deutsch a, de surcroît, commencé tardivement une carrière académique. Elle débuta vraiment quand Olivier Messiaen, autre grand pédagogue, approchait de la fin de ses activités en la matière.
Ayant été le témoin des événements musicaux majeurs s’étant produits durant le 20ème siècle, Max Deutsch donna aussi des cours privés chez lui, rue de Constantinople. Ces cours avaient lieu, devant un large public, chaque vendredi après-midi. Assisté par Françoise Revol, il y analysait des partitions choisies avec libéralité. On y étudiait ainsi Tosca de Puccini, à côté de Schönberg ou de Stravinsky. L’impressionnante liste des élèves les plus connus de Deutsch figure dans la présente exposition virtuelle. Au cours de ces séances, Deutsch étudiait et commentait les travaux de ses disciples. Par contre, il n’était jamais enthousiasmé par la perspective de faire analyser ses propres œuvres.
Comme Deutsch détruisit à la fin de sa vie la majorité des manuscrits de ses œuvres, il est malaisé d’avoir une vue d’envergure de l’ensemble de sa production. Il n’existe pas de catalogue de ses compositions. Par chance, certaines d’entre elles ont survécu. Elles se trouvent à Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret ou dans la collection ayant été constituée par Amaury du Closel. Une classification provisoire de ces œuvres révèle l’existence de pages manuscrites et inédites pour piano seul, d’œuvres pour chant et piano et de quelques autres travaux destinés à des formations diverses.
En ce qui concerne les œuvres pour piano, on notera la présence d’un Glückswunsch daté du 28 janvier 1956, tout comme d’un Bewegt – terme allemand pour Animé – ne comportant pas d’indication d’année. Existe aussi une œuvre inachevée, intitulée Josephina. La partition en est dédiée par Deutsch à sa belle-fille Charlotte. Du côté des pages pour chant et piano, on notera l’utilisation de la langue française dans les textes retenus pour Berceuse et Les Effarés. Si l’on retourne au piano seul, il est enfin le moyen d’écriture initiale de travaux destinés à être ensuite orchestrés. Tel est le cas d’une Marche militaire, présentée par Max Deutsch en 1954 pour un concours de composition suscité par le grand éditeur britannique Boosey & Hawkes.
D’une manière générale, les manuscrits de la main de Deutsch sont rédigés avec une écriture soignée. On le constate également en examinant la copie effectuée par ses soins du Concerto pour neuf instruments opus 24 d’Anton Webern. Cette œuvre dodécaphonique fut écrite en 1934 et dédiée à Schönberg. Nous est également parvenu un fragment destiné à dix instruments et à des chanteurs d’un très bref opéra commandé en 1923 à Deutsch par le célèbre metteur en scène russo-soviétique Constantin Stanislavski (1863-1938). L’ouvrage devait s’intituler Schach, autrement dit Jeu d’échecs.
Ce fragment, écrit à Berlin et à Vienne en septembre et en octobre 1923, indique que l’action est aux mains de joueurs d’échecs. On y voit des parties chorales, respectivement confiées à des pions blancs et noirs. S’exprime, par une notation très proche du Sprechgesang schönbergien, un roi blanc. L’esthétique de Max Deutsch est donc conforme aux directives à lui enseignées par son maître. Elle porte témoignage de l’attitude de Deutsch à l’égard de l’art lyrique d’avant-garde, représenté par les activités berlinoises de la légendaire Kroll-Oper, dont le directeur musical était Otto Klemperer. De toute évidence, Deutsch se tenait à distance des orientations conservatrices suivies à l’Opéra de l’avenue Unter den Linden, symbole de l’art lyrique destiné à la noblesse comme à la grande bourgeoisie.
Si Deutsch ne se rendit pas – comme d’autres Autrichiens et d’autres Allemands – en Union Soviétique afin de participer aux initiatives radicales alors en cours, il importe de souligner ici l’intérêt qu’il avait pour l’activité de Stanislavski.