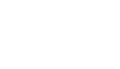La France,
une seconde patrie

La France,
une seconde patrie
D’abord sujet de l’empire austro-hongrois, Max Deutsch est devenu – en s’installant en France et en acquérant sa nationalité – ressortissant d’une nation qui, avant la Seconde Guerre mondiale, régnait sur un empire colonial. Au fur et à mesure des années, le musicien sera le témoin de la diminution d’une emprise planétaire, comme il avait été le témoin du démantèlement de sa patrie de naissance. La fin du règne des Habsbourg-Lorraine et la proclamation de la 1ère République d’Autriche sont décidés en 1919, après la signature du Traité de Saint-Germain. Il entre en vigueur l’année suivante, soit en 1920.
Cinq ans plus tard, Max Deutsch quitte Berlin pour Paris. Jacques Hébertot (1886-1970), le directeur du Théâtre des Champs-Élysées, n’étant plus en état de pouvoir l’engager comme chef d’orchestre, Deutsch doit trouver d’autres moyens de subsistance. Le sérieux absolu de la formation de Deutsch et ses compétences professionnelles le font remarquer. Il collabore avec une connaissance viennoise également devenue parisienne, la soprano Marya Freund. Ils donnent ensemble le Pierrot lunaire de Schönberg. Mais leur apostolat ne suscite pas de nombreuses réactions. Le ressentiment des Français à l’égard du monde germanique demeure vivace. Deutsch devra encore patienter nombre d’années avant de devenir un passeur. Il reprend ainsi le rôle de Gustav Mahler ayant nourri des amitiés avec Georges Clémenceau ou avec le compositeur Gustave Charpentier. Par contre, Deutsch ne fut pas à l’origine du contact entre Francis Poulenc et Arnold Schönberg, s’étant produit à Vienne en 1922.
Deutsch fonde à Paris, en 1925, le Jüdischer Spiegel, un théâtre juif, cherchant à concurrencer les scènes yiddishophones établies dans la capitale française et y attirant un public populaire. Deutsch est au nombre de ceux pour lesquels le yiddish relève d’une vision du monde nuisant à l’entrée des Juifs dans une société moderne. Il retrouve plusieurs compositeurs autrichiens, parmi lesquels figure Anton Webern. Venant de Barcelone pour rallier Vienne, ce dernier passe à Paris et s’y arrête en 1932. Le sens du contact inhérent à Deutsch lui permet aussi d’élargir le cadre de son aventure professionnelle et humaine. Il entretient des relations confraternelles avec André Jolivet (1905-1974), Manuel Rosenthal (1904-2003), Henri Dutilleux (1916-2013) ou encore René Leibowitz (1913-1972), adepte rigoureux de la technique dodécaphonique, se disant élève de Schönberg. Les années suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale tourneront progressivement au pugilat entre Leibowitz et le jeune Pierre Boulez, ayant été son élève. Pour sa part, Deutsch ne peut rester étranger à ces démêlés. Il observe aussi que Serge Nigg, un autre élève de Leibowitz, se détourne de lui.
Pleinement intégré à la vie musicale de notre pays, Deutsch était au Théâtre des Champs-Élysées quand l’Opéra d’État de Vienne y effectua – en 1952 – la création française du Wozzeck d’Alban Berg sous la direction de Karl Böhm (1894-1981). Au cours de l’entracte, Boulez eut un échange des plus vifs avec le critique musical Bernard Gavoty (1908-1981), farouche ennemi de l’avant-garde. Les deux hommes en vinrent aux mains. Cette anecdote illustre les tensions qui régnaient alors parmi le milieu musical parisien.
Ayant gardé un accent viennois prononcé, Deutsch parlait un français devenu magistral. Les entretiens radiophoniques avec lui le prouvent. Partisan de l’adage yiddish « Vivre comme Dieu en France ! », Deutsch ressentait une grande fierté en raison de son intégration dans notre société. En dépit de la trahison représentée par le régime de Vichy et des traces incurables laissées par celui-ci parmi les milieux israélites, il regardait la France comme la réalisation de l’aspiration universelle aux Droits de l’homme. Deutsch concevait la culture nationale comme un trésor universel. En témoignent les propos suivants, extraits du manuscrit autographe inédit d’une conférence sur Paris donnée par ses soins : « L’air de Paris est celui de l’aventure. Elle vous attire, vous la cherchez, vous êtes à sa poursuite et vous finissez par la trouver à Paris. »
Le musicien utilisait la langue française comme un idiome universel dans sa correspondance. Une preuve – parmi d’autres – s’en trouve dans des échanges scripturaires avec son confrère italien Luigi Dallapiccola. Résulta donc de cette conjonction d’éléments l’entrée de Max Deutsch dans la nationalité française. Ses états de service parmi la Résistance aidèrent fortement à sa naturalisation, effectuée en 1947. Se vivant comme un authentique Français, Deutsch agit aussi comme un médiateur culturel. Figuraient parmi les interprètes ayant travaillé avec lui pour diverses manifestations le baryton Jacques Herbillon (1936-2003), le violoniste Gérard Jarry (1936-2004), l’altiste Serge Collot (1923-2015) ou les membres du Quintette à vent de Paris.
Deutsch effectua des tournées de concerts ici et là, en Belgique, en Suisse ou en Italie, prospectant nombre d’organisateurs et d’institutions étrangères. Parmi celles-ci figuraient les autorités de la République Démocratique allemande (RDA). Deutsch entretint une correspondance avec celles-ci, notamment après qu’elle eut été reconnue par la France en 1973. Il s’affaira pour se produire au Centre culturel français de Berlin-Est. Mais ces démarches ne furent pas couronnées de succès. Pourtant, Deutsch avait la nostalgie du Berlin de sa jeunesse. Il avait bien connu Hanns Eisler, importante figure de la vie musicale en RDA et ancien élève de Schönberg.
Max Deutsch n’hésita jamais à se rapprocher des plus hautes autorités pour tenter de parvenir à se produire dans divers pays, au titre des échanges artistiques entre la France et ces nations. Existent de sa main plusieurs lettres à Valéry Giscard d’Estaing (1926-2020), alors président de la République, en faveur d’interventions à caractère culturel. La personnalité et les réalisations de Deutsch furent couronnées – au soir de sa vie – par l’attribution de la Légion d’honneur, la plus haute distinction honorifique de notre pays.