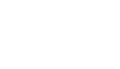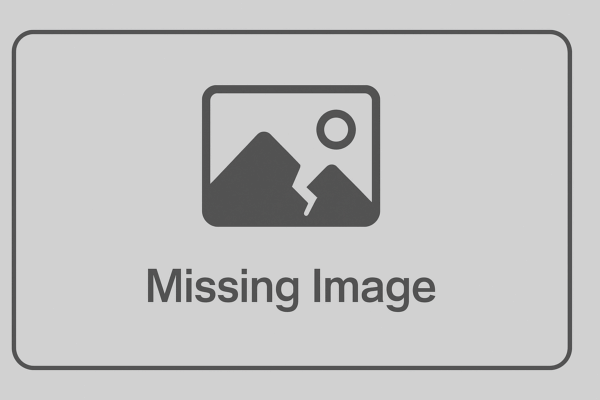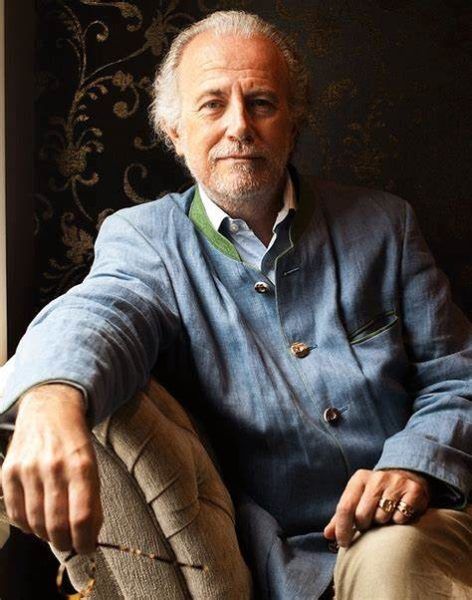Les élèves
de Max Deutsch

Les élèves
de Max Deutsch
Au cours de sa carrière de professeur de composition, tant à l’École normale de musique (ENM) de Paris qu’à titre privé, Max Deutsch aura enseigné environ trois cents élèves de toutes provenances. La venue de Deutsch à l’ENM constitua une espèce de révolution. D’aucuns s’opposèrent à sa présence, jugée trop progressiste. En outre, le souvenir des prises de position politiques d’Alfred Cortot (1877-1962), le célèbre fondateur de l’ENM, permit de prendre acte de l’innovation représentée par l’arrivée du maître d’origine autrichienne boulevard Malesherbes. Bien qu’il ait été lui-même formé par Arnold Schönberg à Vienne, l’homme de haute taille qu’était Max Deutsch représentait désormais l’un des grands courants de l’école française de composition. En l’accueillant, l’ENM s’ouvrait de manière manifeste à l’innovation.
Les origines nationales des disciples de Deutsch furent variées. Appartenaient à ses élèves français des personnalités aussi différentes qu’Amaury du Closel (1956-2024), Gérard Condé (*1947), Philippe Manoury (*1952), Yves-Marie Pasquet (*1949) ou Patrick Marcland (*1944). Selon les termes de ce dernier dans un courriel adressé en 2024 à l’auteur du présent texte, « Deutsch nous donna un vrai accès à la Vienne musicale d’entre les deux guerres. » On aura garde de ne pas oublier dans cette énumération Marcel Goldmann (*1934), installé en Israël après avoir étudié auprès de Deutsch de 1962 à 1967. Cette référence au Proche-Orient peut mener à l’Afrique du Nord dont est originaire Ahmed Essyad. Le compositeur marocain fut valorisé par Deutsch, affirmant haut et fort qu’un musicien issu de l’Islam était parfaitement à même de s’entendre avec un formateur juif. Ces propos furent tenus en 1976, peu après la création mondiale d’Identité, une cantate d’Essyad. La formule fit mouche. Le bassin méditerranéen apporta aussi à Deutsch un disciple grec en la personne de Kyriakos Sfetsas (*1945), ayant fui la Grèce des colonels.
À une époque où la globalisation n’existait pas, certains venaient de très loin pour étudier avec Deutsch. Tel fut le cas du Japonais Naohiko Kai (* 1932). Il en alla de même avec le Chilien Cirilo Vila Castro (1937-2015) et avec son compatriote Jorge Arriagada (1943-2024), plus tard naturalisé français. Bénéficiaire d’une bourse du gouvernement du quai d’Orsay, Arriagada étudia avec Deutsch à partir de 1965. Il se fit ensuite une réputation comme compositeur de musiques de film. Si l’on regarde à présent l’Amérique du Nord, on constate que Deutsch aura eu au moins six élèves ressortissants des États-Unis. Il devait s’agir de David Chaitkin (1938-2011), ayant également étudié chez Luigi Dallapiccola, d’ Edward Cohen (1940-2002), d’ Eugénie Kuffler (*1949), d’Allen Shearer (*1943), de W. Niel Sir, disparu en 2023, et de Dean C. Taylor (*1943).
La notoriété de Deutsch outre Atlantique résultait certainement du fait qu’il était un apôtre diligent de Schönberg, lui-même le maître d’une personnalité appelée à devenir ensuite aussi fameuse que John Cage (1912-1992). Cependant, Deutsch n’avait pas – entre les deux côtes américaines – l’emprise de Nadia Boulanger (1887-1979), ennemie déclarée du sérialisme. Courait aux États-Unis, depuis les années 1930, une rumeur selon laquelle le courant dodécaphonique y avait été introduit pour conduire la jeunesse musicienne autochtone à la … perdition ! Si l’on reste dans le monde anglophone, on notera que Deutsch fut aussi le formateur de Sylvia E. Hallett (*1953), une ressortissante britannique.
Pour sa part, la Scandinavie délégua deux artistes suédois auprès de Max Deutsch. L’un était l’organiste Sven-Eric Johanson (1919-1997), fasciné par le système dodécaphonique. L’autre fut Gunnar Bucht (*1927), également élève de Carl Orff (1895-1982), l’auteur des Carmina Burana. De son côté, l’Allemagne fédérale se vit représentée par Klaus Metzger (*1951). D’autres de ses compatriotes ne vinrent pas à Paris afin de se former auprès de Deutsch. Les années de l’après-guerre virent les astres d’Olivier Messiaen (1908-1992) et de Pierre Boulez croître de façon considérable outre Rhin, notamment en raison des cours d’été qu’ils donnaient à Darmstadt. Ils présentaient aussi l’avantage de ne pas avoir été de vraies victimes du régime nazi, même si Messiaen avait été prisonnier de guerre durant neuf mois en Silésie.
Le parcours relatif aux origines des disciples de Max Deutsch passe maintenant par deux autres pays, situés au sud de l’Europe. L’Italien Sylvano Bussotti (1931-2021) suivit ses cours à partir de 1956. Sa patrie connaissait alors de vives tensions politiques, opposant les démocrates-chrétiens au Parti Communiste italien. Quant aux Espagnols Félix Ibarrondo (*1943) et Luis de Pablo (1930-2021), ils fuyaient la main de fer du franquisme. Le premier d’entre eux était basque. Ils avaient soif d’élargir leur univers musical, en raison de l’isolement de l’Espagne. Deutsch avait un intérêt particulier pour la péninsule ibérique. N’avait-il pas enseigné la musique de film à Madrid, peu de temps avant le début de la Guerre civile ?
Notre approche serait incomplète si l’on omettait de remarquer qu’au moins deux femmes – Eugénie Kuffler et Sylvia E. Hallett – se trouvèrent sous la houlette de Max Deutsch. Il reprenait en cela l’attitude de Schönberg, n’ayant jamais manifesté de la misogynie et ayant enseigné Vilma von Webenau (1875-1953). S’agissant en outre de ses disciples chilien, espagnols et grec, Deutsch les considérait avec l’esprit d’un militant engagé contre l’obscurantisme et l’oppression. Doté d’une nature généreuse, il ne se plaignit jamais que Kyriakos Sfetsas ait soumis certaines de ses œuvres à son compatriote Iannis Xenakis (1922-2001), lui-même devenu parisien. Les disciples de Deutsch lui dédièrent aussi un certain nombre d’œuvres. Tel fut – par exemple – le cas d’Amaury du Closel avec ses Trois Lieder sur des textes de Georg Trakl, pour voix grave et piano.
L’attitude de Max Deutsch à l’égard de ses disciples avait un côté paternel. Il n’hésitait jamais à rédiger des attestations ou des lettres de recommandation en leur faveur. Tel fut – entre autres – le cas pour Marcel Goldmann en 1970. Quelques années auparavant, en 1967, Deutsch signa même une préface pour l’ouvrage Luis de Pablo : portrait d’un compositeur. Il parut chez Tonos, un éditeur de Darmstadt.